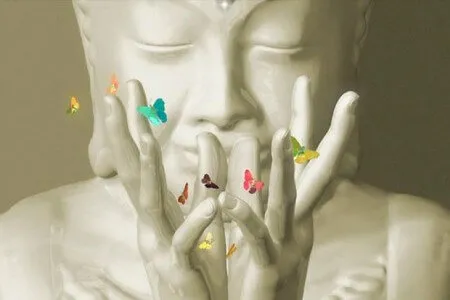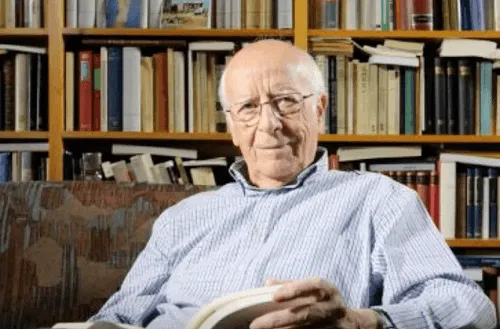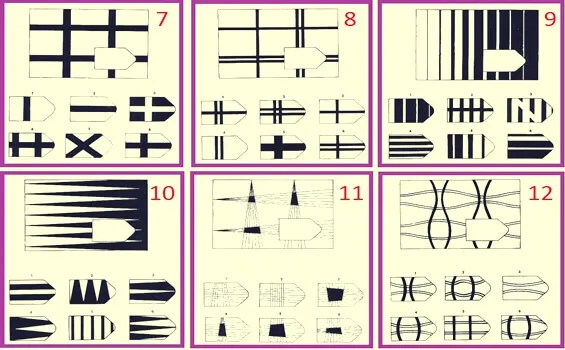Transfert et contre-transfert sont deux termes récurrents en psychanalyse. Ils servent de piliers à la pratique clinique car ils constituent un élément fondamental de la relation analytique. Bien qu’il s’agisse de deux concepts différents, transfert et contre-transfert sont clairement indissociables.
La rencontre analytique cède la place à l’interrelation patient-analyste un espace dans lequel l'inconscient peut circuler le plus librement possible . C’est dans cette interrelation que commence la dynamique entre transfert et contre-transfert respectivement du côté du patient et de l’analyste.
Qu’est-ce que le transfert ?
Le terme transfert elle n'est pas exclusive à la psychanalyse mais est également utilisée dans d'autres domaines. Ce qui semble exister est un dénominateur commun : faire allusion à l'idée de déménager ou de substituer un lieu à un autre . Ainsi, par exemple, cela peut être observé dans les relations médecin-patient ou élève-enseignant.
Dans le cas de la psychanalyse, elle est comprise comme la recréation de fantasmes infantiles dont le destinataire est le analyste . Le transfert constitue la superposition de quelque chose d'ancien sur quelque chose d'actuel, devenant ainsi un espace privilégié pour progresser vers la guérison.

Freud considérait initialement le transfert comme le pire obstacle au processus thérapeutique. . Il y voyait une résistance de la part du patient à accéder à son matériel. inconscient . Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que sa fonction venait à bout de cette résistance.
Dans son texte Dynamique de transfert de 1912, Freud présente donc lele transfert comme phénomène paradoxal : bien qu’il constitue une résistance, il est fondamental pour l’analyse. C'est à ce moment que se distingue le transfert positif (fait de tendresse et d'amour) du transfert négatif (vecteur de sentiments hostiles et agressifs).
En général, le sujet ne se souvient pas de tout ce qui est oublié et refoulé mais il le fait. Il ne le reproduit pas comme souvenir mais comme action ; il le répète sans savoir naturellement qu'il le fait.
-Sigmund Freud-
Contributions d'autres psychanalystes sur le concept de transfert
Après Freud, de nombreux travaux ont été consacrés à la question du transfert, revisitant le sujet et le comparant avec le développement originel du phénomène. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle repose sur la relation entre l'analyste et le patient .
Alors pour Mélanie Klein le transfert est conçu comme une reconstitution au cours de la séance de tous les fantasmes inconscients du patient. Lors du travail analytique, le patient évoquera sa réalité psychique et utilisera la figure de l'analyste pour revivre des fantasmes inconscients.
Dans la conception deDonald Woods Winnicottle phénomène de transfert en analyse peut être compris comme une réplication du lien maternel, d’où la nécessité d’abandonner une neutralité rigoureuse. L'usage que le patient peut faire de l'analyste comme objet transitionnel tel que décrit dans son article Objet transitionnel de 1969 donne une autre dimension au transfert et à l'interprétation. Il affirme que le patient a besoin de la connexion thérapeutique pour réaffirmer son existence.
Connexion transférentielle
On a donc dit que le transfert concernait la recréation de fantasmes infantiles en les projetant sur la figure de l'analyste. Pour que cela se produise, il doit d'abord s'établir une connexion de transfert qui permettre le patient de les recréer fantasmes et de travailler avec eux.
Pour créer cette connexion, il faut qu'une fois que le patient accepte son désir de travailler sur le problème, il se rende à un rendez-vous avec un analyste censé avoir connaissance de ce qui se passe. Lacan l'appelait Sujet censé savoir. Cela produira le premier niveau de confiance dans la relation qui laissera ensuite place à un travail analytique.
Cependant, tout au long du parcours analytique, certaines manifestations peuvent survenir auxquelles l'analyste doit prêter attention et gérer de manière appropriée. Par exemple:

Naturellement ils peuvent des manifestations de contre-transfert peuvent également survenir . Dans ce cas également, l'analyste doit être prudent et s'analyser si cela se produit : se disputer avec le patient avoir l'impulsion de demander des faveurs au patient rêver du patient avoir un intérêt excessif pour le patient incapacité à comprendre le matériel à analyser lorsque le patient rapporte des problèmes similaires à d'autres vécus par l'analyste négliger de maintenir la rigueur nécessaire réactions émotionnelles intenses liées au patient, etc.
Qu’est-ce que le contre-transfert ?
Le terme contre-transfert a été introduit par Freud dans Les perspectives futures de la thérapie psychanalytique È décrit comme la réponse émotionnelle de l'analyste à des stimuli provenant du patient en raison de son influence sur les sentiments inconscients de l'analyste.
L'analyste doit être conscient de ces phénomènes pour une raison simple : ils pourraient devenir un obstacle au traitement. Bien qu'il existe également des auteurs qui soutiennent que tout ce qui est ressenti dans le contre-transfert et qui ne concerne pas l'analyste peut être communiqué ou rapporté au patient.
Il se peut que communiquer à l'analyste les sentiments suscités par le patient engendre une prise de conscience de ceux-ci ou de une meilleure compréhension du processus de la relation thérapeutique. Quelque chose qui jusque-là n’avait peut-être pas été partagé avec des mots. Par exemple, en revivant une scène de son enfance, l’analyste commence à se sentir triste ; cependant le patientil l'interprète et le vitcomme la colère. L'analyste peut communiquer ce qu'il ressent afin que le patient établisse un contact avecle vraiémotion masquée par la colère.
Relation entre transfert et contre-transfert
D'une part, le contre-transfert se définit par sa direction : les sentiments de l'analyste par rapport au patient. En revanche, il est défini comme un équilibre qui ne cesse d'être une preuve supplémentaire que la réaction de chacun n'est pas indépendante de ce qui vient des autres .
Transfert et contre-transfert s’influencent mutuellement.
En ce sens, le contre-transfert peut être un obstacle si l'analyste se laisse emporter par les sentiments qu'il commence à éprouver envers le patient (amour, haine, rejet, colère) ; la loi d'abstinence et de neutralité est violée et il doit démissionner. À ce stade, loin d’apporter des bénéfices, cela gêne le travail analytique.
De cette façon le point de départ est le transfert du patient . Celui-ci communique ou prouve toutes ses expériences et l'analyste ne répond qu'à ce que dit le patient avec ce qui lui semble pertinent sans mettre ses sentiments dans les interventions qu'il effectue. Le patient revit ses fantasmes et les met en œuvre mais ne le fait pas consciemment, c'est pourquoi l'interprétation joue un rôle fondamental dans la traitement .

Fonction de transfert et de contre-transfert
L'analyse présuppose que le lien transférentiel du patient avec son analyste est déjà établi. . C’est dans le jeu entre transfert et contre-transfert que vont émerger des sentiments, désirs, tolérances et intolérances inconscients.
À partir de la relation transférentielle, l'analyste peut faire des interventions : interprétations, signes, coupures de séances, etc. Mais ce n'est que si le lien transférentiel est établi qu'il est possible d'effectuer un travail plus profond. Sinon, les interventions ne créeront pas le même effet.
Dans la relation analytique donc, une neutralité rigoureuse de la part de l'analyste ainsi qu'une écoute fluctuante qui le dépouille de sa subjectivité, de son ressenti et de son histoire permettront d'utiliser le transfert comme canal d'un travail thérapeutique. L'analyste doit devenir une sorte d'écran vide dans lequel le patient peut transférer son propre matériel inconscient.