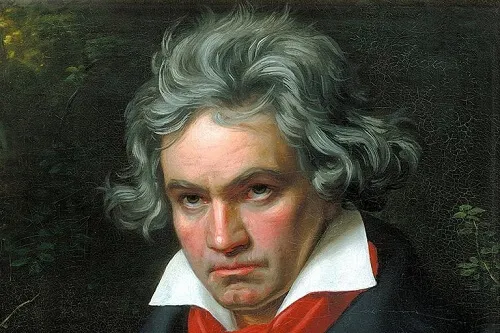Tout comme il existe une structure neuroanatomique et neurofonctionnelle qui explique le comportement humain Il existe également une neurobiologie de l'alcoolisme . Voyons ce qui se passe dans le cerveau d'une personne dépendante à l'alcool.
L'alcool est la drogue légale la plus consommée. Capable de générer une dépendance physique et psychologique, elle représente un lourd fardeau social et économique pour la communauté. Selon l'OMS, l'alcoolisme touche 140 millions de personnes dans le monde et constitue la cinquième cause de décès prématuré.
Il existe un grand nombre de pathologies liées à la consommation d'alcool de la tuberculose au VIH et aux infections. Eh bien, que se passe-t-il dans notre cerveau après avoir bu de l'alcool, surtout lorsqu'il y a un problème de dépendance à cette substance ? Voyons ce que dit la neurobiologie de l'alcoolisme à ce sujet.
La neurobiologie de l'alcoolisme : étiologie
L'étiopathogénie de l'alcoolisme implique un interaction complexe entre des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux.
Les facteurs génériques ou héréditaires sont des éléments dépendance . Une prédisposition congénitale peut expliquer jusqu'à 60 % des cas d'alcoolisme.

D'un point de vue biochimique, le risque de souffrir d'addiction à l'alcool est lié à certaines variations des gènes qui codent pour les protéines de deux enzymes spécifiques : le alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase.
Outre l'origine héréditaire possible, d'autres causes neurobiologiques sont émises. Parmi ceux-ci les réduction de l'activité de l'enzyme MAO-A (mono-amino oxydase de type A); C’est la même réaction que certaines personnes ressentent après un événement traumatisant.
De faibles niveaux de MAO-A ont été associés à un comportement antisocial accru, qui constitue à son tour un facteur de risque d'alcoolisme.
Bien entendu, il existe d’autres explications plus comportementales à l’étiologie de l’alcoolisme. Ceux-ci font référence aux expériences d’apprentissage et aux traits de personnalité. Dans la pratique, ce n’est pas l’essence qui change, mais seulement l’approche.
Hormones et neurotransmetteurs dans la neurobiologie de l'alcoolisme
Il a été démontré directement et indirectement que l'alcool est capable d'interagir avec un large éventail de neurotransmetteurs du système nerveux . Cette interaction se produit en raison du caractère liposoluble de l’éthanol qui lui permet de traverser la barrière hémato-encéphalique (BBB) et ainsi d’atteindre le cerveau.
Les neurotransmetteurs et hormones susceptibles d’interagir avec l’alcool éthylique sont les suivants :
- opioïdes endogènes
- dopamine
- adrénaline et noradrénaline
- sérotonine
- facteur de libération de la corticotropine (CFR)
La dépendance à l'alcool se caractérise par un déficit de la capacité à réguler physiologiquement les systèmes endogènes de motivation et de récompense. On suppose que différentes structures cérébrales sont responsables de ces systèmes qui ont un impact sur le comportement humain. Parmi ceux-ci, on mentionne par exemple le système limbique, l'amygdale, l'hippocampe, le noyau caudé, le noyau accumbens et le lobe frontal.
Un dysfonctionnement de ces systèmes pourrait être à l’origine de phénomènes liés à l’alcoolisme tels que la dépendance à l’alcool, l’intoxication alcoolique ou le syndrome de sevrage.
Les effets de l'alcoolisme
La consommation d'alcool produit un effet désinhibiteur et dépressif sur le système nerveux central . Le premier se caractérise par le blocage et l’altération des structures et processus cérébraux liés, par exemple, à la pensée, à la réflexion ou aux valeurs éthiques. Cela stimule également l’impulsivité et renforce de manière incontrôlable certaines émotions.
Certaines fonctions cognitives très importantes sont donc influencées de manière plus ou moins permanente . Ceux-ci incluent le fonctions exécutives des lobes frontaux, de la mémoire, des compétences visuospatiales, du contrôle moteur et oculomoteur.
L'implication des fonctions exécutives dans la consommation d'alcool se manifeste généralement par de l'impulsivité, une apathie affective, un manque de jugement, des troubles de la concentration, une désinhibition et une perte de motivation.

L’effet désinhibiteur de l’alcool se traduit également par un effet motivant et renforçant secondaire ; en effet, cela nous permet d'adopter des modèles de comportement que nous ne suivrions pas en état de sobriété. L’alcool peut donc procurer un sentiment transitoire de liberté, d’empathie et d’intensification des émotions.
Une consommation substantielle et soutenue d’alcool est généralement nécessaire avant que le cerveau ne s’engage dans un comportement addictif.
La ligne générale Le développement de l’alcoolisme peut s’expliquer par les effets de renforcement positifs que l’alcool produit sur le cerveau. . La consommation d'éthyle active le système de récompense et génère des sensations agréables qui amènent notre cerveau à désirer par la suite plus de consommation.
Combattre l’alcoolisme, c’est possible
Pour lutter contre l'alcoolisme, nous disposons de diverses ressources et soutiens offerts par les soins de santé. . Se confier à son médecin est la première étape pour entamer une démarche de désintoxication alcoolique.
Comme nous l’avons vu, la neurobiologie de l’alcoolisme explique comment et pourquoi les comportements abusifs d’alcool se développent. La raison pourrait être un écheveau compliqué à démêler mais il faut en tout cas garder l'espoir que les nombreuses approches existantes pourront être d'une grande aide.