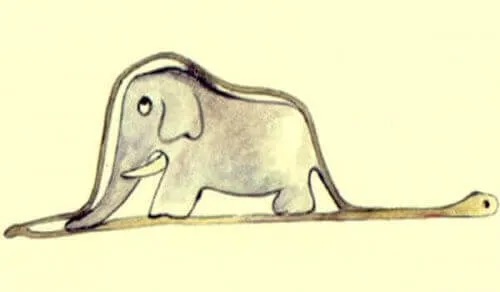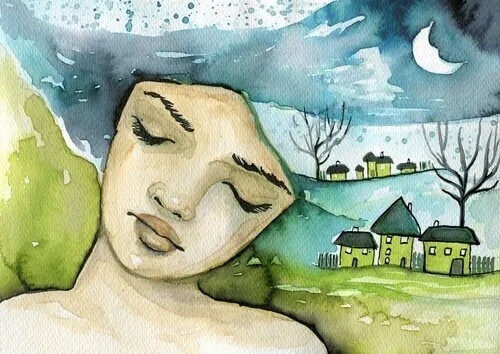Le paradoxe d'Easterlin est un concept qui se situe à mi-chemin entre la psychologie et l'économie. . Aussi étrange que cela puisse paraître, ces deux sciences se retrouvent très souvent à explorer un territoire commun. L’un d’eux est lié aux concepts d’argent, de capacité de consommation et de bonheur. Des concepts explorés directement dans Paradoxe d'Easterlin.
Personne ne peut nier l'importance de l'argent . On entend souvent dire que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais il est également vrai que nous nous sentons souvent frustrés précisément parce que nous ne disposons pas de ressources financières suffisantes pour acheter ce que nous voulons : un voyage, un cours, de meilleurs soins médicaux.
Doit
– Antoine Rivaroli –
Le paradoxe d'Easterlin vise à renforcer l'idée selon laquelle le fait d'avoir argent et être heureux ne sont pas deux réalités liées. Examinons en détail cet intéressant paradoxe.
Le paradoxe d'Easterlin
Le paradoxe d'Easterlin trouve son origine dans l'esprit de l'économiste Richard Easterlin. La première réflexion qu’il a faite était globale et concernait une réalité que beaucoup d’entre nous connaissent : les pays avec les habitants les plus riches ne sont pas les plus heureux . Dans le même temps, les pays aux revenus les plus faibles ne sont pas les plus malheureux.

Ce simple postulat étayé par des preuves contredit la croyance selon laquelle un niveau de revenu plus élevé correspond à plus de bonheur . La première question était donc de savoir si l’atteinte d’un certain niveau de bien-être économique limitait d’une manière ou d’une autre la capacité d’être heureux.
Le paradoxe de Pâqueslin cela nous montre également qu'en analysant les différences de niveau de richesse au sein d'un même pays, les résultats changent. Sur un même territoire, les gens avec moins d’argent sont en réalité moins heureux . Comment ça se fait?
Le paradoxe d’Easterlin renforce l’idée selon laquelle avoir beaucoup d’argent et être heureux ne sont pas des réalités indivisibles.
La relativité du revenu économique
Pour expliquer tous ces aspects, Easterlin a utilisé une métaphore de Karl Marx. Ce dernier disait que si une personne pouvait compter sur une maison capable de satisfaire tous ses besoins, elle pourrait se sentir satisfaite. Mais si quelqu'un commençait à construire un somptueux palais à côté de cette maison, c'est à ce moment-là qu'il commencerait percevoir sa maison ressemble à une cabane.
Partant de ce concept, Easterlin est parvenu à deux conclusions. La première est que les personnes qui reçoivent un revenu économique plus élevé ont tendance à être plus heureuses. La seconde est que les gens perçoivent leur revenu comme élevé en fonction du revenu économique de ceux qui les entourent . Cela explique donc la différence dans la relation entre le bonheur et la capacité de dépenser au sein d’un même pays et entre tous les pays.
Le paradoxe d'Estearlin nous met donc en garde sur la manière dont la perception de notre bien-être est conditionnée par les comparaisons que nous faisons avec les personnes qui nous entourent. . En d’autres termes, le contexte est déterminant pour déterminer si les intrants économiques produisent ou non du bonheur.
Revenu économique ou équité ?
Richard Estearlin n'a jamais déclaré ouvertement que des revenus économiques plus ou moins élevés étaient la cause directe du sentiment de bonheur ou de tristesse . Ce que soutient le paradoxe d’Estearlin, c’est qu’un niveau de revenu élevé ne génère pas nécessairement un plus grand sentiment de bonheur. Cette dernière dépend en effet du contexte social.
De là se pose une autre question : est-ce que ce serait l’équité plutôt que le revenu économique qui engendrerait le bonheur ou le malheur ?

À partir du paradoxe d'Estearlin Peut-on penser que de grandes différences de revenus dans une société soient source de malaise ? Dans des conditions de grande inégalité, se sentir économiquement supérieur aux autres pourrait générer un sentiment de plus grande satisfaction dans la vie. Au contraire, se sentir inférieur à la majorité peut provoquer frustration et la tristesse.
Dans aucun des deux cas, la question ne concerne directement la satisfaction des besoins. Cela signifie que nos revenus peuvent nous permettre de vivre sans difficultés majeures mais si nous nous apercevons que les autres vivent mieux que nous, nous considérerons nos gains comme insuffisants.
C’est probablement ce qui se passe dans les pays très riches. Même si les besoins de la majorité de la population sont satisfaits la répartition des richesses entre les classes sociales supérieures sape les sentiments de confort et de bonheur. Au contraire, dans les pays pauvres où la grande majorité de la population vit avec de faibles revenus économiques, il est plus facile d’épanouir le bonheur.