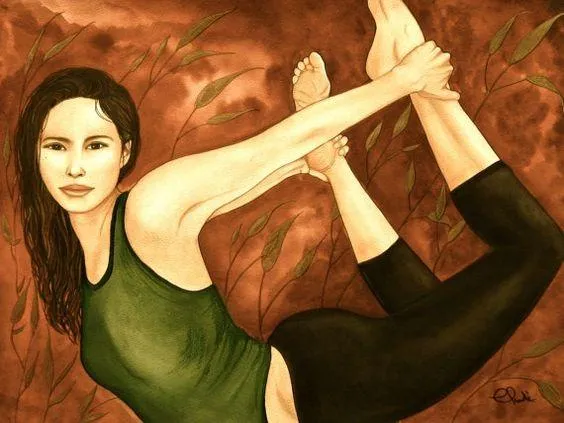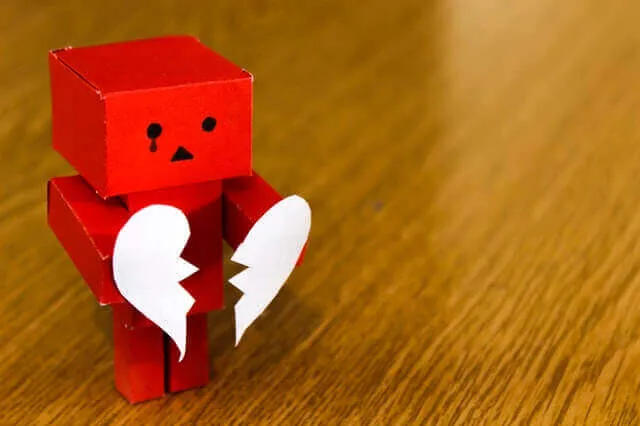Midi arrive et nous commençons à avoir faim. Les minutes passent et la sensation devient de plus en plus aiguë. Il faut se mettre quelque chose dans le ventre ! Mais nous sommes trop occupés et nous ne pouvons pas. Il est deux heures et soudain nous nous rendons compte que nous n'avons plus faim. Combien de fois avons-nous entendu dire que j’avais perdu l’appétit ? Sans aucun doute différentes théories sur la faim apportent différentes réponses à la question : pourquoi mangeons-nous ?
La réponse semble évidente : parce que nous avons faim. Mais est-ce vraiment la raison ? En partie oui, alors pourquoi avons-nous parfois faim ? Pourquoi mangeons-nous plus que ce dont nous avons besoin quand nous avons notre plat préféré devant nous ? Je n'ai plus faim mais je ne peux pas y résister et alors on mange jusqu'à éclater.
Ci-dessous nous présentons le théories sur la faim plus significatif. Celles qui expliquent notre comportement alimentaire et qui nous proposent une réponse aux questions précédentes.
Théories sur la faim
Hypothèse de point de consigne
La théorie du point de consigne ou de la valeur de référence attribue la faim au manque de énergie . Lorsque nous mangeons nous rétablissons donc notre niveau d’énergie optimal également appelé point de consigne énergétique.
Selon cette hypothèse nous mangeons jusqu'à nous sentir rassasiés, au moment où nous arrêtons de manger car notre point de consigne a été rétabli. Autrement dit, l’acte de manger a rempli sa fonction, nous ne répéterons donc pas cette action tant que notre corps n’aura pas brûlé suffisamment d’énergie pour nous ramener en dessous de cette valeur de référence.
Le système de consigne est composé de trois mécanismes :
- Goût .
- Ce que nous savons des effets de cet aliment spécifique.
- Le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que nous l'avons mangé.
- Le type et la quantité de nourriture déjà présente dans l’intestin.
- La présence ou l'absence d'une autre personne.
- Niveaux de glycémie.

Tous les systèmes à points de consigne (Wenning 1999) sont des systèmes à rétroaction négative c'est-à-dire que la rétroaction résultant d'un changement dans une certaine direction produit des effets compensatoires dans la direction opposée. Ces systèmes se trouvent généralement chez les mammifères et leur objectif est de maintenir le homéostasie .
Si cette théorie était exhaustive, une fois que nous aurions atteint notre valeur de référence, nous devrions arrêter de manger. Mais ce n’est pas toujours le cas, n’est-ce pas ? Continuons ensuite notre voyage à travers les théories sur la faim.
Théorie glucostatique
Au milieu du siècle dernier, plusieurs chercheurs pensaient que la prise alimentaire avait pour objectif de maintenir les bons niveaux de sucre dans le sang. Cette théorie est connue sous le nom de glucostatique. Autrement dit, nous mangeons lorsque la glycémie baisse et nous arrêtons de le faire une fois que les valeurs normales sont rétablies.
Théorie lipostatique
Une autre hypothèse de la même période est la théorie lipostatique. Selon ce système, chacun de nous a une valeur de référence de graisse corporelle. Les comportements à la table seraient donc motivés par la nécessité de rétablir ce point.
Limites des théories des points de consigne
La première limite à laquelle cette théorie doit faire face est le fait que il ne prend pas en compte l’importance du goût des aliments, de l’apprentissage et des facteurs sociaux. Les plats que nous aimons et les dîners conviviaux entrent en jeu. Imaginez avoir devant vous votre plat préféré et un plat qui ne vous plaît pas particulièrement. Ce qui se produit? Vous prendrez probablement moins du plat qui ne vous passionne pas, tandis que du premier vous mangerez jusqu'à ce que vous soyez rassasié et au-delà. Bien sûr : on peut manger même sans avoir faim. De cette façon le consommation alimentaire il n'est plus contrôlé par des écarts dits de consigne.
Lowe (1993) a déclaré que plus de la moitié des Américains présentent déjà un excès significatif de dépôts graisseux lorsqu'ils s'assoient pour manger. Cela s'applique également à ceux qui sont en surpoids et n'arrêtent pas de manger. Cela seul indique que les théories des points de consigne sont incomplètes.
De plus, si ces hypothèses étaient précises, les êtres humains n’auraient pas survécu jusqu’à nos jours. Pinel Assanand et Lehman (2000) soutiennent que Les théories des points de consigne sur la faim et la prise alimentaire ne sont pas cohérentes avec les pressions évolutives fondamentales sur la prise alimentaire telles que nous les connaissons.
Les chercheurs expliquent que nos ancêtres avaient besoin de manger une grande quantité de nourriture en prévision des périodes de famine. De cette façon, ils stockaient les calories sous forme de graisse corporelle. Si la théorie du point de consigne était rigide, ils auraient dû arrêter de manger une fois l'écart rétabli et lorsque la nourriture aurait été épuisée, ils n'auraient plus eu de réserves caloriques.

Théorie des incitations positives
Selon cette théorie, ce qui pousse généralement les humains et les animaux à manger n’est pas le manque d’énergie mais le plaisir anticipé de ce qui nous attend (Toates 1981). Ce Plaisir c'est ce qu'on appelle la valeur incitative positive.
Un estomac vide est un mauvais conseiller.
-Albert Einstein-
L’hypothèse est que les diverses pressions subies au cours de l’histoire en raison du manque de nourriture nous ont conduits à désirer de la nourriture. A
L'appétit que nous ressentons dépend de l'interaction de plusieurs facteurs :
Théories de la faim : tout n’est pas ce qu’il semble être
Avec cette revue des principales théories sur . Un tel geste habituel et quotidien n'est pas facile à expliquer puisque l'on ne mange pas seulement quand on a faim mais aussi pour le plaisir que nous procure la nourriture.
D'autre part, le psychologue Jaime Silva (2007) souligne que les émotions et les humeurs influencent également la consommation alimentaire. Selon Silva, d’une part nous sommes conditionnés par l’humeur et les émotions. Mais la nourriture peut aussi changer émotions et l'état d'esprit. Une fois de plus, nous constatons que les théories précédentes ne couvrent pas toutes les explications de la consommation alimentaire.
La vie est une combinaison de pâtes et de magie.
-Federico Fellini-
Silva déclare que l'influence des émotions sur la nourriture comprend la désinhibition ou la restriction de la nourriture
À quelle fréquence mangeons-nous pour calmer notre anxiété ? Combien de fois avons-nous perdu l’appétit pour la même raison ? Sans aucun doute, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour enrichir la littérature scientifique relative aux théories sur la faim.